# 082 / 221
Franchement, en réécoutant University, je me suis demandé pourquoi j’avais gardé en mémoire que Throwing Muses avait horriblement mal vieilli. Etait-ce les bribes restantes d’un Real Ramona de 1991, vinyle que je possédais depuis des lustres et qui n’est jamais ressorti de sa pochette ? Car après avoir été agréablement surpris par Red Heaven (cassettes 046 et 047), voilà que je prenais grand plaisir avec son successeur, enregistré deux ans après en 1994. J’aurais dû m’en douter, car s’il est vrai qu’une moitié seulement de l’album avait été retenue (le début et la fin, il doit y avoir un bon ventre mou entre les deux), University est le seul disque des Muses que j’ai racheté en CD depuis.
On y retrouve ces arpèges de guitares irrésistibles et énergiques fort bien soutenus par une paire rythmique sobre et professionnelle, le tout avec un son bien mieux produit que je le craignais. Plus que jamais la formule trio met en valeur le songwritting et le chant de Kristin Hersh, entre mid tempo teinté de grunge et titres plus lents s’étalant en vagues obsédantes (le « Fever Few » final). Les titres retenus ont fort bien résisté à l’usure du temps, Kristin Hersh ajoutant quelques nouvelles perles bien rock (« Shimmer », « Flood ») à son indispensable collier discographique. De quoi se demander pourquoi je n’ai jamais emprunté (ni écouté jusqu’à présent) le successeur d’University, Limbo (1996), ultime disque des Throwing Muses avant la récente réactivation – à cause de l’hideuse pochette, peut-être ? Pour les prochaines retrouvailles sur ces cassettes, nous explorerons plutôt le début de carrière du groupe, période 80’s où Tanya Donelly officiait encore à la guitare, dans l’ombre de sa charismatique demi-sœur.
Il y a quelques mois est sorti Girly-Sound to Guyville, luxueuse réédition pour fêter les 25 ans de Exile in Guyville dans laquelle on trouve quantité de demos ayant précédé l’enregistrement de ce disque culte. Le mot est lâché, et il est loin d’être galvaudé, tant le culte en question semble avoir aujourd’hui complétement pris le dessus sur la vingtaine de chansons composant cet album. Et cela avait d’ailleurs commencé dès 1993, lorsque Liz Phair en fit habilement, par le seul rapprochement des titres, la réponse d’une nana au Exile in Mainstreet des Rolling Stones, alors que musicalement seuls quelques accords sur les refrains des chansons les plus rock’n roll (« 6’1 », « Mesmerizing ») peuvent éventuellement rappeler la bande à Jagger (comme 50 % des albums de rock des 90’s, quoi…).
Cette réécoute tombait donc à pic, pour voir notamment s’il convenait d’investir dans ce coffret 3 CDs, l’album original étant bien entendu en ma possession depuis des lustres. La réponse se dessinait quand même assez vite, dans la mesure où je n’avais retenu à l’époque qu’une grosse moitié du disque, et que la plupart de ces chansons finalisées sont bien Lo-Fi, c’est-à-dire qu’elles ressemblent déjà furieusement à des demos. Planquées derrière les quelques tubes évidents de l’album (comme l’immédiat « Never Said »), il y a en effet quantité de petits folks ou chansons tristes dont beaucoup font penser à Lisa Germano (la superbe et délicate « Canary »). Mais, partant peut être des mêmes fêlures, si Lisa Germano semble une victime brisée, Liz Phair se rebiffe pour garder le contrôle. C’est flagrant sur « Girls ! Girls ! Girls !» (1), où la chanteuse balance tristement « i get full advantage of every man i meet ». Ainsi, là où les quelques filles du grunge s’affirment en combattantes hargneuses de la domination mâle (L7, pour citer un exemple que je connais bien), Liz Phair préfère se mettre à hauteur d’homme et prendre naturellement et en douceur ce qui lui convient, c’est-à-dire très souvent (et pour parler aussi crûment qu’elle dans ses chansons) une bonne baise sans lendemain. Et d’assumer son « Fuck and Run » (2), sport très masculin à l’époque, ou de s’amuser à nommer joliment « Flower » une paillarde dont le texte, assez facilement traduisible (magnifique « i want to be your blowjob queen »), me faisait rougir jusqu’aux oreilles (il faut dire que je n’ai jamais pratiqué le Fuck and Run et que je n’avais affaire qu’à des filles bien sages qui n’auraient certainement pas osé dire « every time i see your face i get all wet between my legs »)
Sans doute parce qu’elle était à la fois plus explicite et accessible que ses consœurs (PJ Harvey sortait Rid of Me la même année), Liz Phair fut donc investie du costume de première féministe moderne du rock indé, un costume bien encombrant pour celle dont le disque parlait tout autant d’amour, de blessures, de sentiments et d’humour que de sexualité décomplexée. Un décalage qui explique en partie pourquoi, de déception en ratage, on a fini par ne parler de Liz Phair que lors des rééditions (2008, et 2018 donc) d’Exile in Guyville. Un peu à la manière d’Alanis Morissette et son Jagged Little Pill.
(1) Une réponse à ces queutards de Motley Crue et leur album de 1987 ?
(2) Pas retenu à l’époque, mes sélections sont parfois assez inexplicables….
Certains évoquent un tournant dans la carrière de Sonic Youth, un moment où ils ont basculé du noisy punk au rock indé expérimental intello. On entend quelquefois les vieux fans parler de Dirty pour ce passage, ou alors de ce Washing Machine, mais peut être que la transition s’est faite progressivement, sur une décennie, ou peut-être qu’elle n’a simplement jamais existé et que Sonic Youth a toujours été un groupe inclassable, naviguant entre les styles et se moquant des modes. Difficile d’en juger, car je ne fais pas partie de ces fans de la première heure, et mes emprunts à la médiathèque se sont étalés entre la cassette 9 et la 212, complètement dans le désordre et avec pas mal de manques (ce qui signifie que les albums de Sonic Youth étaient très populaires et souvent empruntés). Ce qui est sûr, c’est que l’étincelle qui mis vraiment le feu aux poudres pour moi fut le « Wildflower » trouvé sur le Tibetan Freedom Concert, et que le baril de poudre en question fut ce Washing Machine emprunté peu après. C’est à partir de ce moment que j’ai raccroché à la discographie du groupe (que je maitrise donc beaucoup mieux dans sa deuxième moitié, l’année 1995 étant pile son hémistiche), et je cite toujours cet album comme mon favori. Ceci mériterai quand même une vérification aujourd’hui en me retapant les 18 albums dans l’ordre (d’autant que je ne avais pas retenu celui-ci complètement, zappant notamment les 20 minutes de « the Diamond Sea », peut être pour des raisons d’économie de bande), mais en tout cas la réécoute de cette cassette n’a pas infirmé mon impression.
Les interrogations de mon introduction sont assez représentées par les deux premiers morceaux : « Becuz » et son rythme lent, son chant chuchoté, ses mélodies métalliques, s’oppose à un « Junkie’s Promise » bien crade, plein de dissonances, mutant en un long final Krautrock instrumental. Par la suite, Sonic Youth s’emploiera à mélanger tout ça avec une maitrise incroyable. Mais pour moi, cet album est avant tout celui où Kim Gordon fait tout pour s’imprimer définitivement dans les fantasmes d’adolescents qui voyaient déjà en elle l’une des rares gonzesses du circuit à allier classe, attitude rock n’roll et physique avenant. Imaginer Kim, agressive, prendre les devants et s’envoyer en l’air sur une machine à laver que ses comparses guitaristes s’emploient à imiter sur le final du fantastique morceau éponyme n’a d’égal que de l’entendre ahaner sur « Panty Lies » dont le titre est une porte ouverte sur tout un tas de rêves interdits (à vrai dire, si je ne doute guère du sujet de ces chansons, les paroles en sont assez obscures, et j’espère bien qu’elles évoquent une situation plaisante plutôt que glauque). Musicalement, on atteint le sublime fréquemment, notamment sur ce « No Queen Blues » qui commence en transe hypnotique sur laquelle viennent se greffer des guitares aux soli tout à la fois mélodiques et biscornus, avant que le refrain n’explose en chant bien punk et que le titre tourne en final apocalyptique. Vraiment, Washing Machine me semble le sommet de la carrière de Sonic Youth, entre les aspérités parfois trop abrasives des débuts et la routine un peu trop contrôlée de la fin.
Edit : j’ai réécouté ce disque après la rédaction de l’article, et concernant les manques : « Saucer-Like » est nulle, « Little Trouble Girl » dispensable, « Skip Tracer » plutôt bonne et « the Diamond Sea » assez bonne, mais dure 10 minutes de trop. Il y a donc moyen que je trouve mieux que Washing Machine, même si certaines chansons retenues sur cette cassette font indéniablement partie de mes toutes favorites de Sonic Youth.

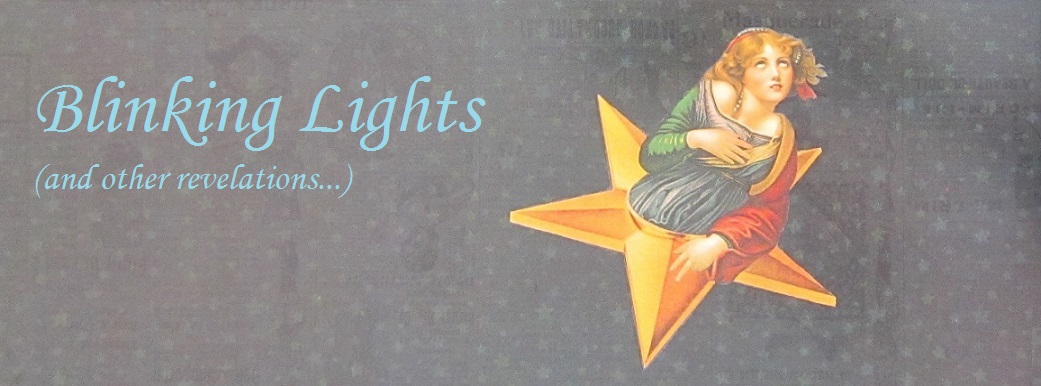






/image%2F0404514%2F20240411%2Fob_806baa_r-182893-1159472297.jpg)
/image%2F0404514%2F20240404%2Fob_39b7bd_r-3115901-1375638245-9524.jpg)
/image%2F0404514%2F20240328%2Fob_188b42_r-6662862-1430419204-9117.jpg)
/image%2F0404514%2F20240321%2Fob_db1d1d_r-413475-1259196752.jpg)