NEW ROCK Part III - the LIBERTINES / BABYSHAMBLES / the VINES / HUSHPUPPIES
Et voici les quatre derniers groupes, the LIBERTINES, BABYSHAMBLES, the VINES et HUSHPUPPIES, avant le classement final des meilleurs albums et meilleurs titres....
The LIBERTINES
Difficile de dissocier le nom du groupe et les histories de son bouillant leader, Pete Doherty. Si ses problèmes de drogue et ses continuelles bastons avec son compère Carl Barat ont naturellement contribué à faire parler des Libertines, il ne faut pas oublier qu’à la base se trouve Up the Bracket, excellent brûlot sorti en 2002 qui leur valut le titre de meilleur nouveau groupe aux NME Awards. Dans mon esprit les Libertines proposaient plutôt un punk rock basique, quelques accords avec un son crade, agrémentées de conneries potaches dans une pure rock n roll attitude non feinte. Certes, quelques bons titres (dont le premier « Vertigo » ou « Up the bracket » sonnant très Ramones) donnaient raison à cette vision caricaturale, mais je constatais rapidement que l’écriture des deux anglais était beaucoup plus complexe et originale que ça. « Tell the King » par exemple, hésite entre guitares mélodiques et accords énergiques, comme composée par deux artistes aux tempéraments opposés. Tout l’album est ainsi sur le fil du rasoir, entre passages posés et harmonieux et dissonances calculées, chant tranquille et beuglements rauques. The Libertines peuvent autant se marrer à vociférer et partir dans tous les sens (le déjanté « Horrorshow », ou « the boy looked at johnny », à la fois joyeux et désespéré) que faire preuve d’une nostalgie émouvante sur le superbe « Good old days ». Une constante cependant, ils enregistrent toujours avec un son brut, presque live, liant de manière homogène des titres bien variés (ce qui est un des signes d’un bon album). Même sur la surprenante ballade « Radio America », on dirait qu’ils ont fait exprès de légèrement désaccorder leurs guitares acoustiques et de mettre le micro contre les cymbales de la batterie pour garder cette sonorité. Pour couronner le tout, les tensions qui peuvent exister dans le groupe ne se sentent pas du tout à l’enregistrement : sur le difficile « Boys in the band », avec ses multiples rythmes et son refrain à la Beatles coupé par des accords rageurs, tout est merveilleusement en place, que ce soient les deux voix ou la basse assurant la tenue du titre pendant les concours de solo des guitaristes. Avec leurs efforts pour mettre en avant leur coté rebelle (ils finissent l’album sur un punk des familles bien puissant), the Libertines en feraient presque oublier la richesse de leurs compositions (en tout cas comparé à pas mal de leurs suiveurs) : ne vous laissez pas piéger et écoutez cet album !
L’enregistrement de the Libertines en 2004 s’est fait de manière inespérée et précipitée au cours d’une rare période de réconciliation (relative) entre Pete Doherty et Carl Barat. Dans ces conditions, on pouvait s’attendre à un album bâclé et mis en vente précipitamment avant que les porte monnaies sur patte que sont les fans ne s’intéressent à un autre groupe. Il n’en est rien, même si on sent parfois que la première prise a été la bonne, histoire de pas trop prolonger les séances de studio baston. Au contraire, les deux leaders ont mis leur histoire houleuse au service de deux bons singles explicitement intitulés « Can’t stand me now » (véritable joute verbale chantée) et « What became of the Likely lads ». L’ensemble est quand même moins percutant que « Up the Bracket », le son étant assez propret et les compos plus lisses. Cela dit, la diversité des formats est encore de mise, couvrant tout les tempos, de la ballade acoustique (« musics when the lights go out ») au court lâchage punk (« Arbeit Macht Frei »). Les influences sont assez perceptibles, surtout les Clash, mais aussi Damned (sur « the saga ») ou New York dolls sur l’irritant « Don’t be shy ». La qualité des compos est la plupart du temps correcte, peu de loupés (« the ha ha wall »), et peu de vrais surprises (comme le long morceau bluesy « Road to Ruin », avec de l’orgue). Loin d’être l’obligation commerciale attendue, mais sans atteindre l’inventivité de son prédécesseur, the Libertines confirme le talent des membres du groupe, qui resteront légitimement comme des références de la nouvelle scène pour beaucoup de jeunes rockers. Pete Doherty, s’il maintient son objectif de poète maudit (en France on a eu Gainsbourg dans le rôle), pourrait en vieillissant écrire des choses plus marquantes, surtout s’il se frotte à son âme sœur honnie partie entre temps fonder le groupe Dirty Pretty Thing, à moins bien sur qu’il ne casse sa pipe (de crack) avant, comme tant d’autres….
BABYSHAMBLES
Le deuxième groupe de Pete Doherty confirme ses qualités de compositeur, bien loin de l’image de branleur anarchiste qu’on a voulu donner de lui. Down In Albion débute direct par une grosse surprise, un conte à la Famille Adams intitulé « La belle et la bête », avec Kate Moss ajoutant un charme magique à ce titre dont l’ambiance n’est pas sans rappeler les derniers Dionysos. Accompagné du bon single au refrain fédérateur « Fuck forever », ce démarrage nous donne un aperçu de ce qui aurait pu être un excellent album. Hélas Down in Albion souffre d’un unique mais rédhibitoire défaut : il est beaucoup trop long ! A coté de rocks bien troussés (« Killamangiro ») se trouvent des titres bancals (« a rebours ») ou carrément chiants (« in love with a feeling »). Vraiment dommage, car les Babyshambles savent varier les rythmes et les ambiances, reprenant notamment le mélange rock reggae cher aux Clash sur « Stick and stones » ou « What Katy did next ». La fin de l’album est en cela assez réussie, avec des touches nostalgiques (« Back from the dead »), un titre mélodique avec un peu d’harmonica (« loyalty song »), une longue saga comme les Damned en ont produit, et qui a même des sonorités Radiohead période Pablo Honey (« Up the morning ») et enfin un final acoustique tout tranquille. Les Babyshambles avaient donc moyen de faire aussi bien que the Libertines, en supprimant le ventre mou graisseux de cet album (allez hop, 6-7 titres en moins !). Un défi à relever….
Dur dur, au cinquième morceau de Shotter’s Nation je n’ai toujours aucun commentaire à faire sur l’album ; si ce n’est le refrain teinté de nostalgie du single « Delivery » qui fonctionne bien, l’encéphalogramme de l’album reste désespérément plat malgré les efforts des Babyshambles pour alterner accords, arpèges et effets rythmiques. Pas même un gros défaut à soulever, ou une aversion pour ces compositions de Pete Doherty : rien ! Alors que l’angoisse de l’article blanc commence à me titiller, retentit le riff guitarier de « Crumb begging », introduisant un morceau d’influence très Stonnienne. L’intérêt de l’album est relancé, et chaque titre y va de son ambiance et de son inspiration. « Unstookie Titled » est un long titre mélodique dont les passages instrumentaux et le chant assez doux créent la surprise. On ne s’attend pas à ce genre de morceau en écoutant du « nouveau rock », et que dire de ce jazzy « There she goes » qui voit l’excellent bassiste saisir une contrebasse dans un style nouvelle scène française : on s’attendrait presque à voir Sanseverino débarquer… Les deux rocks suivants (dont un boogie endiablé) bénéficient de riffs d’intro particulièrement réussies et réveillent l’album à coup de refrains enthousiastes. C’est là que ma culture musicale montre ses limites, car il me semble que les bonnes idées développées sur ce décollage tardif ne sont pas toutes sorties de l’esprit embrumé du jeune Pete, j’ai quand même l’impression d’avoir entendu tout ces riffs quelque part… Mais accordons lui le bénéfice du doute, et saluons son ultime performance, « Lost Art of Murder », une triste ballade acoustique dans la veine des productions les plus émouvantes de l’écorché Johnny Thunders. Comme pour le premier album, de bonnes surprises et une volonté d’aller hors des sentiers battus assez honorable, mais aussi pas mal de déchets (ici regroupés dans la première moitié de l’album) qui forment un disque déséquilibré et du coup très moyen.
The VINES
L’écoute du premier album de the Vines, Highly Evolved, m’a ramené dans mon propre passé. En un sens, leurs influences sont plus récentes que la plupart des groupes précédents, mais comme j’ai vécu la période grunge (contrairement au punk), je me suis revu il y a une quinzaine d’années plongé dans la vague déclanchée par un album appelé Nevermind. Car le court morceau d’introduction, « Highly evolved », semble tout droit sorti des violents brûlots de Nirvana. Cependant, on ne retrouvera le groupe de Seattle que sur « Get free », car même si l’esprit du grunge (son de guitare et chant) flotte sur tout l’album, les chansons des Vines résonnent de nombreuses autres influences. A commencer par celle de Silverchair : qui se souvient de ce groupe, sorte de Muse du grunge, c'est-à-dire très techniques et doués mais trop « besogneux » (compos complexes, enregistrements « léchés ») pour être touchants en permanence ? Pour ceux qui ont oublié, écoutez les ballades « Autumn Shade », « Country Yard » (celle là est sympa) ou « Mary Jane » (celle là est très sirupeuse, et bien révélatrice des défauts de ce style). A ce fond joli mais peu original et qui m’a moyennement enthousiasmé, the Vines viennent greffer des titres différents : « Outtathaway ! », chant hurlé, basse en avant et refrain explosif, qui se rapproche de la nouvelle scène garage, le dansant « Sunshinnin’ » évoquant les compos de Franz Ferdinand et même une ballade au piano qui m’a rappelé les bons vieux Guns N’ Roses (« Homesick »). Mais la vrai surprise, c’est « Factory » : on dirait une reprise d’Abba dont le refrain aurait été enregistré par les Foo Fighters, vraiment détonnant ! L’album se termine sans heurt par un long titre alambiqué à la Silverchair assez surproduit, dont la seule vraie étincelle est une belle mais courte accélération.
Il fallait s’y attendre, les Vines n’ont plus eu d’idée surprenante et n’ont conservé pour ce Winning Days que le « fond joli mais peu original et qui m’avait moyennement enthousiasmé » du premier album. Et encore, joli, il faut vraiment se concentrer pour entendre par ci par là les arpèges méritant ce qualificatif. En fait, l’album semble uniquement constitué de deux titres : primo, un grunge violent et hurlant (avec la variante couplets calmes refrains explosifs) qui casse pas des briques mais à au moins une qualité énergisante. L’album débute par trois chansons du styles, rendant même « TV Pro » presque intéressante avec le son aérien des guitares du couplet. Secundo, des ballades chiantes comme sur Highly Evolved (ils ont même repris « Autumn Shade » !), qui plus est majoritaires. Je défie quiconque de ne pas s’endormir après l’infernal enchaînement « Rainfall » « Amnesia » « Sun Child ». the Vines a prévu le coup et nous réveille en sursaut sur le dernier titre, beuglé et électrisé comme il se doit… Un album à peine bon à mettre en fond sonore pour des taches ménagères….
A priori pas de changement sur Vision Valley. Toujours le même son, toujours l’influence grunge, en bref pas un monument d’originalité. Et pourtant il passe beaucoup mieux que son prédécesseur. A cela une raison majeure, le format de l’album : douze titres de 3 mn maxi et une demi heure au total, un rythme qui permet d’éviter l’ennui, d’autant plus que les Vines ont cette fois mis l’accent sur leur coté énergique. Il reste encore un coté naïf à leurs compositions, mais l’ensemble est nettement plus efficace (« don’t listen to the radio », « fuck yeh »). Plus la chanson est courte et sans fioritures, meilleure elle est, à l’image de l’expéditif « gross out ». Les quelques ballades sont toujours aussi culcul (dans le style des pires productions des Foo Fighters) à l’exception de « Vision Valley » plus inspirée, aux mélodies plus accrocheuses à défaut d’être inventives. Après un enchaînement de titres courts, on écoute donc sans problème le dernier titre de plus de 6mn, « Spaceship », qui propose en plus de beaux arpèges en intro une partie instrumentale bien vue, de longs accords planant sur des roulements de batteries très travaillés avant un solo qui fait mouche. En résumé, le fond reste identique mais la forme est nettement plus agréable, faisant de Vision Valley un album dispensable mais agréable.
HUSHPUPPIES
Après avoir écouté des groupes de toute la planète (UK, USA, Danemark, Suède, Australie,…) je voulais finir par un groupe Français. Peu de représentants de ce nouveau rock dans l’hexagone, mais il en est un qui mériterait d’être plus connu, c’est Hushpuppies. Bon je ne vais pas réinventer la poudre, je replace la critique de the Trap que j’avais déjà mise sur ce blog l’été dernier…
On sent d’emblée que ce groupe a forgé ses armes dans des concerts un peu partout avant de sortir the Trap, à l’inverse de certains combos à la mode sortis du chapeau au bon moment commercial. Les cinq gars maîtrisent en effet parfaitement leur sujet, sur des rocks très énergiques pas toujours évidents à négocier. « Marthelot ‘n’ clavencine » est un bon exemple des transitions bien carrées que les Hushpuppies sont capables d’exécuter, le calme et la tempête alternant d’une manière à la fois naturelle et surprenante. Ils évitent cependant les fioritures et savent faire preuve de simplicité pour des titres d’une efficacité redoutable, notamment grâce à des refrains accrocheurs très bien trouvés (« You’re gonna say yeah ! », le bien nommé « Single »). Quel que soit le thème abordé, on sent une certaine nonchalance dans le propos, une façon de ne pas se prendre au sérieux (ou de se prendre faussement au sérieux) bien mise en scène sur la pochette, illustration de leur chanson « Alice in Wonderland ». C’est d’ailleurs sur ce titre qu’on les entend gueuler « I feel alright », à l’instar d’un autre groupe de punks rigolos, les précurseurs Damned. La deuxième partie de l’album, introduite par la ballade « Comptine », est plus calme, et fait appel à de belles secondes voix. « Bassautobahn » est ainsi rendue plus lugubre et se rapproche des compos d’Elista. Hushpuppies choisissent de finir leur album bizarrement : encadrant « the Trap », chanson piège dans laquelle je vous laisse tomber, on trouve en effet leur deux seuls titres empreints de nostalgie. Variation tout à l’honneur du groupe, mais ne collant pas vraiment à leur style, et placée en fin comme faute d’un meilleur endroit. On retiendra en outre l'équilibre peu commun des instruments: contrairement à de très nombreux albums rock, la basse ne fait pas ici de figuration, et le clavier n'est pas là que pour faire joli, chacun des membres du groupe s'exprimant au moment opportun : voici un premier disque vraiment sympa, et qui ne se prend pas la tête malgré ses indéniables qualités, autant dire une rareté à l’heure actuelle…
Malgré le titre de leur deuxième album, Silence is golden, les Hushpuppies n’ont pas mis de sourdine sur leurs instruments et attaquent par plusieurs titres dans la lignée de the Trap. C’est d’abord « A trip to Vienna », démontrant qu’ils n’ont pas perdu la main pour accélérer une chanson à priori calme, avec des arpèges et des beaux chœurs en intro et un rythme infernal en conclusion. L’album se poursuit sur un tempo rapide, avec notamment le détonnant « Moloko Sound Club », les refrains sont toujours aussi efficaces et les paroles festives peuvent se résumer à ce slogan : « Here we are to live young and fast ». Le premier ralentissement intervient sur « Love Bandit », et les premières interrogations aussi (« You realize that everything that you’ve done has consequences »). Dès lors, le ton est plus triste, et les invitations à profiter de la vie sonnent plus comme des tentatives désespérées de repousser la fin. Musicalement, cela se traduit par un ralentissement des titres, une basse omniprésente et une ambiance parfois similaire à des compositions de Air. Cependant les Hushpuppies manient toujours la variation de rythme avec brio, et savent maintenir l’intérêt grâce notamment aux mélodies du chant bien travaillées. Le groupe termine sur une chanson lugubre intitulée « harmonium », dont l’ambiance musicale est bien en phase avec l’histoire spectrale d’un amoureux assassiné. Ce titre est sans doute à l’origine de la pochette où l’on voit dans une maison abandonnée le groupe à moitié transparent croiser une créature de rêve, ou de cauchemar… Un album moins joyeux que le précédent, mais qui augure quand même de bons moments de folie en live : les français n’ont pas à rougir de leur recrue, qui est plutôt dans le haut du nouveau panier rock.

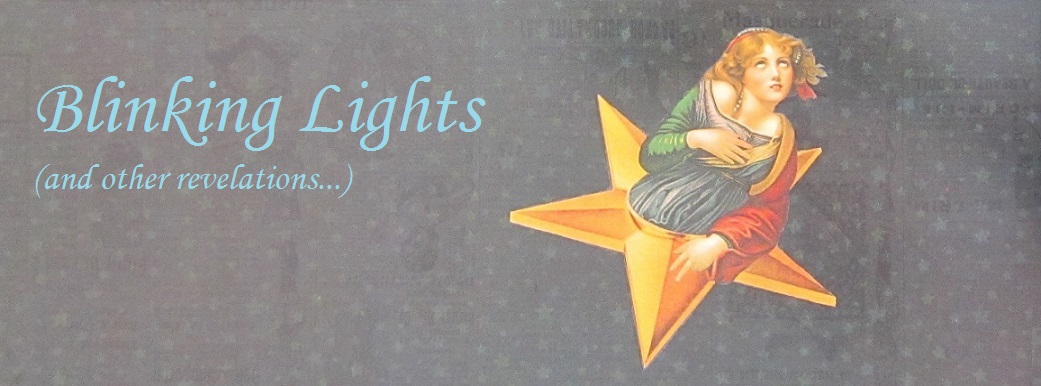

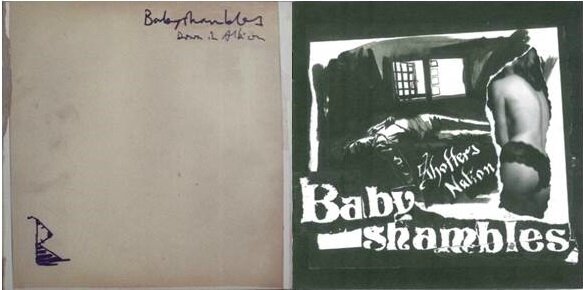
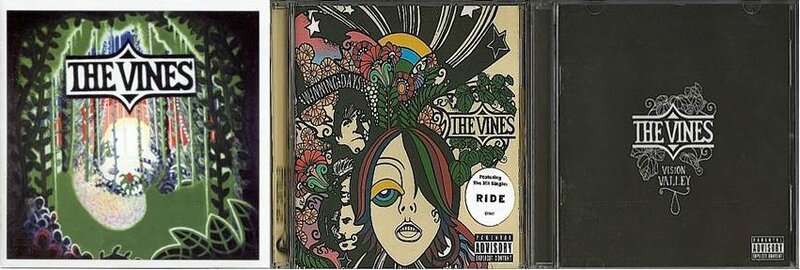
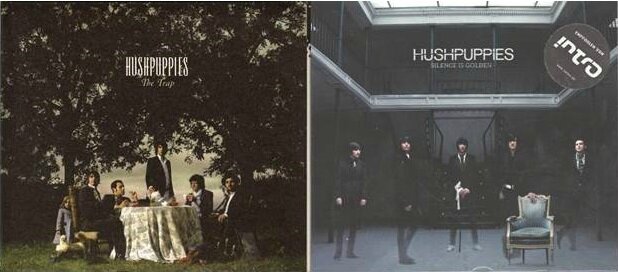


/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F40%2F57%2F1353178%2F112476361_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F79%2F17%2F1353178%2F103668601_o.jpg)
/image%2F0404514%2F20240508%2Fob_425eca_r-383383-1292805893.jpg)
/image%2F0404514%2F20240427%2Fob_cff8bf_img-20240425-203912.jpg)