24 DATES / 28
En avant pour la deuxième partie du
Diamond Dogs (1974) - Schizomusic 30/12/09
On l’a vu, avec Bowie on est souvent tenté de parler d’album de transition, souvent à tort… Avec Diamond Dogs, j’ai pourtant l’impression que cette fois, ce serait à bon escient. D’ailleurs, la pochette n’est elle pas significative, qui montre un hybride entre un chien et le Bowie période Ziggy, comme si celui-ci affichais une dernière fois son visage avant de s’effacer au profit de quelque chose de pas encore très défini ? Car Bowie s’est lancé seul dans la réalisation de Diamond Dogs, puisqu’il avait congédié les légendaires Spiders from Mars juste avant. L’ordre des chansons est d’ailleurs assez symbolique, en premier lieu le glam rock habituel sur « Diamond Dogs » puis le fantôme de « Rock n Roll Suicide » qui vient hanter « Sweet Thing », titre déjà moins conventionnel puisque coupé en deux par le bolide « Candidate », diesel carburant au brame de saxos et sauts de piano. En fait, lorsque « Sweet Thing » reprend, le glam ne fait plus partie de la carrière de Bowie, et c’est noyé sous un déluge de larsens qu’il s’offre une dernière accélération en baroud d’honneur. Dès lors, Bowie semble perdu, et pars un peu dans toutes les directions, pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur c’est bien sur le fameux « Rebel Rebel », un incontournable semblant tiré d’un best of des Rolling Stones, tandis que « Rock n’ Roll with me » serait plutôt un mauvais Beatles… Quant au pire, c’est pour moi ce « 1984 », funk qui n’a pu être enregistré qu’avec Boney M, je ne vois pas d’autre explication… En gestation donc, les futurs tubes à paillettes du disco Bowie. En gestation aussi, le Young Americans, avec la profusion de saxophones qui s’éclatent tout au long de ce Diamond Dogs. Sauf que là, plutôt que principal instrument d’une musique aseptisée destiné à nous envaseliner les portugaises, nous avons enfin ici une utilisation optimale du saxophone, entre accompagnement rythmique bien dosé et pourvoyeur d’ambiance glauque à grands coups de grincements free jazz. Et puisqu’on parle d’ambiance, en gestation aussi le futur binôme Berlinois, sur les titres un peu plus atmosphériques tels que « We are the Dead », peu immédiats mais dont on se rend compte à la longue qu’ils sont aussi très bons. Pour finir, j’ai souvent lu que Diamond Dogs avait aussi été précurseur de Outside, mais mis à part sur la petite intro précédent la chanson titre, je ne l’ai pas retrouvé ici musicalement. Sans doute est il fait allusion aux embryons d’expérimentations sonores qu’on trouve sur Diamond Dogs, ainsi qu’à son thème futuriste et malsain. Quoi qu’il en soit, c’est à un véritable album charnière auquel on a affaire, et même s’il contient moins de tubes marquants que beaucoup d’autres albums de Bowie, il me parait assez indispensable de l’avoir écouté tout aussi attentivement que Mlle Catherine n’a pas manqué de le faire pour rédiger son article….
the Man who sold the World (1970) - Pop Hits 14/12/09 Soon....
Ah le con ! Cette discographie dans le désordre, je l’ai déjà dit, a beaucoup d’avantages, mais là pour le coup elle m’a joué un bien vilain tour… à peine m’étais je ébaubi sur « Station to Station » que je découvrais que 6 ans auparavant, Bowie avait déjà introduit un album avec un long morceau à tiroirs. Dans le rôle du calmage d’entrée, les trois parties de « Width of the Circle » se posent là. Acoquiné avec l’embryon des Spiders from Mars, et un nouveau venu du nom de Mike Ronson, Bowie relègue sa guitare folk en arrière plan et laisse son groupe étaler son savoir faire technique avec plus ou moins de bon gout. La première composition passe nickel malgré sa longueur, l’auditeur naviguant avec plaisir à partir d'un riff descendant entêtant, de solo en pause acoustique (sonnant assez Who) jusqu’à un final rock préfigurant le futur « Jean Genie ». L’aisance des transitions et la qualité des différentes parties du titre en font une composition excellente, mais les deux suivantes moins bonnes laissent éclater au grand jour la surenchère technique des trois sbires accompagnant Bowie. Un coté théâtral rappelant parfois le Alice Cooper Band mais en moins maitrisé (l’apogée de la ressemblance entre les deux extravaguant chanteurs se fera cependant plus loin sur « Saviour Machine », un titre plus réussi). Bowie calme heureusement le jeu avec une ballade qu’auraient pu écrire les Beatles. Mais voilà, les chœurs lugubres et l’espèce de pause à l’orgue de barbarie en font un titre ironiquement bien plus effrayant et transpirant la folie que « All the Madmen », malgré le dialogue et la flute décalée de ce dernier. L’album se poursuit ainsi un peu en dents de scie, le glam rock démonstratif de The Man Who Sold the World se montrant tour à tour efficace (« Running Gun Blues ») et un peu lourdingue (« She Shook me Cold », « the Supermen »). Sans oublier bien sur, le joyau de ballade acoustique perdu dans cet univers électrique, un « the Man who sold the World » au célébrissime riff de guitare qu’il n’est nul besoin de décrire ici plus longuement et qui justifie à lui seul la possession de cet album qui, bien qu’imparfait, fait partie des indispensables de l’homme qui portait des robes… pas comme les demoiselles de chez Christophe, qui les préfère effeuillées….
Station to Station (1976) - Dr FrankNfurter 14/12/09
Etape après étape, le David Bowie Blog Tour se poursuit. Le voici bien avancé, alors que j’aborde ce grand classique. Comment ne pas se montrer trop répétitif, comment trouver l’inspiration ? Et pourtant, David Bowie aura jusqu’à présent su me surprendre à chaque fois (en bien ou en mal d’ailleurs), chaque album ayant sa marque de fabrique, une originalité le rendant unique dans la discographie du Thin White Duke – c’est ainsi qu’il se surnomme lui-même dans le premier titre de cet album, et qu’on l’appellera pendant encore un moment. Comme d’habitude, je me suis bien planté en essayant de replacer ce disque dans la chronologie des œuvres de Bowie. Il faut dire qu’il ne ressemble (heureusement) en rien à son très pénible prédécesseur (Young Americans), et qu’il ne préfigure pas non plus les expérimentations du fabuleux binôme Berlinois qui suivra. Mais qu’est ce qui caractérise donc cet album ? En premier lieu, débuter l’album avec un titre étrange de plus de 10mn, il fallait s’appeler Bowie pour le tenter à l’époque. Certes, le coup des deux titres en un avait déjà été fait par d’autres, mais « Station to Station » est un modèle du genre. Ce lancinant voyage, semblant reproduire le rythme hypnotique d’un train en marche, qui se transforme soudain en son milieu en pop entrainée par un piano joyeux, est encore une originalité parfaitement négociée par David Bowie et son groupe. On craint forcément que la suite ne soit pas à la hauteur de cette entame, or c’est tout l’inverse qui se produit. Carlos Alomar aligne les riffs d’anthologie, et Bowie montre l’étendue de son talent en seulement six titres. « Golden Years » est un modèle de funk, mais est pourtant surpassé par « Stay » et sa guitare extraordinaire. « TVC15 », pop irrésistible, toujours avec un piano guilleret et des claquements de mains, redonnerai la joie de vivre à un poissard dépressif. Dans le registre mélancolique, Bowie aligne deux perles, « Word on a Wing » et « Wild is the Wind », où son chant est tout simplement extraordinaire. « Wild is the Wind », que j’avais découvert en introduction de l’excellent live à la BBC, et dont j’ai appris aujourd’hui avec surprise qu’il s’agissait d’une reprise de Nina Simone, termine l’album de superbe manière, c’est un titre qui fait voyager et rêver comme peu d’autres.
Vous me direz, un guitariste parfait, un groupe à l’aise dans tout les registres, un Bowie au sommet de son art vocalement, c’est du déjà lu, qu’est ce qui différencie donc Station to Station des autres très bons albums de Bowie décrits précédemment ? C’est simple, j’ai cité tout les titres : dans Station to Station, il n’y a pas une seule minute à jeter, fait pour l’instant unique dans la discographie du Mince Duc Cocaïné Blanc. La perfection, nul doute qu’elle sera au rendez vous dans la chronique de ce cher Doc…
Aladdin Sane (1973) - Arbobo 14/12/09
Un défi de taille pour les Spiders from Mars : faire mieux que le classique Ziggy Stardust, album qui avait propulsé l’année précédente Bowie au sommet, qui l’avait définitivement placé parmi les plus grands… Pour la première fois (mais pas la dernière, de loin), David Bowie allait prouver qu’il était capable de relever le défi de l’album attendu au tournant en étant, justement, là où on ne l’attend pas. Déjà, le nom de l’album, la pochette, ont quelque chose de fascinant qui présage du meilleur quant au contenu. Un premier tour de chauffe réussi, « Watch that Man », rock bien balancé comme pour faire transition avec le légendaire album précédent, et Bowie n’attend pas plus pour balancer sa bombe, j’ai nommé Mike Garson le pianiste fou. « Aladdin Sane », titre sur lequel on fait connaissance avec ses envolées de notes hallucinantes, est une des meilleures compositions de notre caméléon favori, une de celles qui après une entame plutôt mélancolique est retournée comme une crêpe par un refrain entrainant en diable. Le cinquième larron, qui collabore encore aujourd’hui avec Bowie, permet au groupe de se renouveler en inventant un son qui sublime leur glam rock déjà pas piqué des araignées. Non pas que les autres soient en reste, loin de là : il faut entendre la basse énorme de « Panic in Detroit », ou Mike Ronson s’en donner à cœur joie sur « Cracked Actor », autre rock Stardustien, pour être convaincu qu’Aladdin Sane n’avait pas besoin de Garson pour devenir un classique ; Sauf qu’à cette époque, pour Bowie, c’était chef d’œuvre ou rien. Et donc « Time », une épopée grandiose et théâtrale d’un style croisé chez Alice Cooper à l’époque et un peu plus tard sur the Wall. On cherche en vain le nom Bob Ezrin crédité, mais Bowie n’a pas eu besoin du producteur cinglé pour écrire cette fresque mélancolique. Puis dans un esprit cabaret, le sympathique « the Prettiest Star », enchainée avec une version déjantée de « Let’s Spend the Night Together », qui alimente bien des regrets quant au futur (et plutôt raté) disque de reprises Pins Up. Aladdin Sane se conclue en montrant tour à tour ses deux profils, par les titres les représentant le mieux : « the Jean Genie », ou le rock basé sur un riff de guitare tout bête transformé comme par magie en tube fédérateur. Et « Lady Grinning Soul », chanson calme et douce emprunte de nostalgie (une ballade, quoi…), qu’on eut trouvé fade chez les autres, et qui est merveilleuse chez Bowie. Sans aucun doute un des meilleurs albums des 70’s, qui ne manque pourtant pas de concurrents, et qui frôle la perfection à un vieillot « Drive in Saturday » près…. (Un album qui prouve entre autres que je n’ai rien contre le saxophone. Il « suffit » de bien l’employer…). Arbobo, peu veinard lors de son premier tirage, a forcément du se rattraper avec celui-ci…
David Bowie (1967) - Arbobo 20/11/09
Je m’attendais à découvrir l’album d’un fan transis de Dylan tentant vainement de l’imiter, et voilà que je me retrouve avec l’album d’un comique troupier, un Fernandel anglophone doué et particulièrement porté sur les cuivres qui chantonne un large sourire jusqu’aux oreilles, et interprète de manière théâtrale des sketches que je n’ai osé traduire. Qui eut cru que le grand David avait commencé sa carrière avec pour accompagnement de la bombarde et des claquements de mains (« Uncle Arthur ») ? On saluera quand même la performance, puisque Bowie a sur son premier album inventé les Têtes Raides 20 ans avant les Français (« Rubber Band », « Little Bombardier »). Dans le registre bordélique et cabotin, il reste cependant assez loin des Who, qui en avaient sorti de bien meilleures… et de bien pires aussi, tant Bowie a eu du mal à étouffer ses talents d’arrangeurs et de chanteur délicat. Au fur et à mesure que l’album avance, on se prend ainsi à écouter plus attentivement les mélodies, on tend l’oreille sur un « When I live my Dream » qui nous évoque, un peu gêné, nos chers Eels, on entrevoit dans le long « Silly Boy Blue » le bientôt compositeur de « Space Oddity », on savoure le guilleret « Come and Buy my Toys », tentative folk annonciatrice des futures merveilles comme « Kooks », avant que tout ne reparte en sucette. A mettre aussi à l’honneur de Bowie pour son premier album les 100 % de compos originales, là ou ces fieffés Beatles (et tant d’autres) avaient farcis leurs premières oeuvres d’une bonne moitié de reprises.
Œuvre de jeunesse un peu honteuse et coupable de remplissages fréquents, David Bowie 67 n’est prometteuse que pour ceux qui comme nous, l’écoutons du haut d’une pyramide de chef d’œuvres produits par notre héros ces 40 dernières années. Car bien malin à l’époque celui qui aurait pu y déceler la graine de future grande star de la pop musique qui était en train d’y germer. Voyons si Arbobo, courageux volontaire, aura plutôt ri ou pleuré….
Hunky Dory (1971) - Le Golb 16/11/09
Dans mon souvenir, Hunky Dory était un album très inégal, entre excellents titres et trucs sans intérêt. Alors que ces prétendus titres oubliables sont très bons, et souffrent simplement d’être associés à des merveilles insurpassables. Ainsi « Eight Line Poem » est un beau petit blues, mais il faut presque l’écouter tout seul pour s’en rendre compte, coincé qu’il est au milieu d’une première face d’album probablement inégalée chez notre cher David. Tiraillé entre sa base folk et des aspirations rock déjà testées sur the Man Who Sold the World, Bowie prend ses auditeurs à contre-pied en permanence. « Changes » et « Oh ! you Pretty Things » semblent ainsi transformer Bowie en crooner, avec un sage piano accompagnant une voix cajoleuse bien en avant, mais c’est sans compter le démarrage de refrains pop parmi les meilleurs que notre héros ait écrit. Le piano occupe la première place dans cet album, avec bien sur en apothéose l’inoubliable intro de « Life on Mars ? ». A un moment de ce DBBT, s’est posé la question de savoir si les chansons de Bowie étaient ou non émouvantes. Le débat reste ouvert, mais quelle que soit la réponse, il y aura au moins ce titre en (contre) exemple. Je pense que personne ne peut rester insensible à cette magnifique mélodie, au chant fabuleux, et aux arrangements idéaux de « Life from Mars ? », figurant dans le best of Bowie de tout amateur normalement constitué. Le pire étant que l’anglais arrive à enchaîner sans dommages, grâce à un petit titre sans prétentions aux accents country folk réjouissant : le piano bar et la trompette discrète de « Kooks » viennent désamorcer l’émotion tenace engendré par « « Life from Mars ? » tout en conservant le niveau de qualité d’Hunky Dory, une prouesse… En fin de première face, « Quicksand » achève de nous convaincre, en compilant tout les talents de Bowie, de la ballade folk au lyrisme en passant par un passage assez rock. C’est sur la deuxième face que se trouvent les morceaux que j’avais oublié. Une belle erreur, car soyons franc, il n’y a quasiment rien à y jeter non plus : seule « the Bewlay Brothers » est en deçà, et encore il s’en faut de peu pour qu’elle ne soit sauvée par son refrain magique et un final complètement fou. A part ça, une reprise évoquant le chant de T-Rex, le piano de Phish et la bonne humeur de Belle and Sebastian (avec même un bon saxo !), le riff de guitare incroyable d’ « Andy Warhol » (et sa production géniale et avant gardiste) et le rock très affirmé de « Queen Bitch » qui annonce la venue de Ziggy Stardust en personne… On ajoute une pochette où un Bowie androgyne s’entoure d’un brouillard de mystère, et qu’obtient-on ? L’un des meilleurs albums d’un des plus grands artistes de tout les temps. Un peu trop imposant pour ma faible prose, mais parfaitement adapté au talent du grand Thom….
Heathen (2002) - Ne Respire Pas 15/11/09
Depuis le début du DBBT09, il y a eu consensus sur la plupart des albums de Bowie. Puisque le bloggueur aime la fight, on a bien trouvé quelques titres, quelques points à discutailler, certains on fait les malins et nagé à contre courant sur un disque, mais dans l’ensemble, il n’y a eu aucun clivage aussi important que ce qu’il se prépare sur Heathen, si j’en juge les nombreux commentaires qui s’y rapportent. Faisant partie des déçus du Païen, cela faisait un moment que je ne l’avais pas réécouté, et je me demandais si je pouvais changer d’avis par rapport à 2002, comme j’ai pu le faire pour l’album Hours. Il faut bien me rendre à l’évidence, ce n’est pas le cas. Sur la première moitié de l’album, c’est le manque d’unité qui m’a troublé. Le premier titre « Sunday » est assez bon, avec sa guitare electro en sourdine, son chant triste en avant et la batterie bien rock qui arrive en toute fin, il nous met dans une ambiance mélancolique dont on sort avec regret dès le deuxième titre, « Cactus ». Ok, Bowie personnalise vite fait le titre en rajoutant un peu de clavier, mais bon, les Pixies, c’est quand même de la reprise de petit bras. A tout prendre, je préfère quand même ce morceau facile au désagréable « I’ve been waiting for you » (d’ailleurs repris aussi par ces même Pixies). Entre les deux nous aurons eu un morceau pleurnichard peu passionnant (« Slip Away »), un morceau bien rythmé séduisant (« Slow Burn »), et un rock sympa quoique très classique (« Afraid »). Bref, une première face pas trop mauvaise mais assez dispersée. Constat inverse pour la deuxième, puisque Bowie explore sur l’ensemble de ses titres une espèce d’electro lyrique que j’ai pour ma part trouvé assez bancale. L’alliage bizarre de rythmes mécaniques rapides et d’envolées de claviers orchestrés développée sur de longues minutes ne m’a pas accroché, exception faite d’un « A Better Future » un peu plus fédérateur, le pire étant atteint avec les sons vieillots de « Everyone says ‘Hi’ ». On est très loin du talent d’alchimiste de Thom Yorke, ce qui est dommage car Bowie a su prouver qu’il pouvait bien mieux faire dans le genre sur certains de ses albums précédents. Reste une des plus belles pochettes de l’anglais qui a dans sa discographie le meilleur et le pire sur ce plan là, mais je persiste en qualifiant Heathen d’album mineur… L’avis d’un novice en Bowietologie, l’ami Tireub du bout du monde, sera peut être tout autre…
Lodger (1979) - Home at Last 11/11/09
Lodger est connu comme étant le troisième album de la trilogie Berlinoise, qui n'a de trilogie que le nom puisque si Low et Heroes sont très proches dans leur construction et leurs sonorités, ce Lodger en est assez éloigné. Il constitue en fait bien plus une seconde paire avec Scary Monsters, notamment dans la manière qu’a l'excellent groupe de porter les titres de Bowie vers des sommets. Le batteur est impressionnant de bout en bout, le bassiste groove comme jamais («DJ», «Red Money»), et Carlos Alomar vient projeter comme d'habitude sur ce tableau d'incroyables solos de guitare tordus. Le seul reproche qu'on peut faire à Lodger, c'est de mettre un moment avant de décoller. Rien de vraiment accrocheur avant «Yassassin», quatrième titre proposant une ambiance orientale que Bowie a convoquée à quelques reprises tout au long de sa carrière. Violon, percussions, et voix nous transportent au magrheb, un voyage qui rattrape la promesse non tenue du premier titre («FantasticVoyage»). A partir de là, Lodger prend une autre dimension, «Red Sails» accélère le rythme pour le plus grand plaisir de Bowie qui s'éclate à tester sa voix sur de nouveaux registres. On craint un virage plus expérimental en deuxième période, comme sur les précédents albums, mais le dynamique groupe enfonce au contraire le clou sur un exceptionnel «Look back in Anger». J'avais entendu la première fois ce morceau sur des enregistrements de la tournée d'Outside, et il était tant intégré à la setlist de ces concerts qu'il m'arrivait de croire qu'il faisait partie de cet album moderne. Le fait est que la plupart des titres de Lodger, tout comme ceux de Scary Monsters, n'ont pas pris une ride, ce qui est plutôt étonnant quand on réécoute les albums qui ont suivis.... Lodger persiste par la suite avec ses joyeux grooves épicés par les notes saturées d'Alomar, qui est à la guitare ce que Mike Garson est au piano: un fou furieux génial et inspiré. Sans être un réservoir à tubes, ni un champ d'expérimentations incroyable, Lodger est plutôt l'œuvre d'un artiste qui sort de sa bulle, aidé par un groupe talentueux qui s'amuse. Emporté par son élan, Bowie ira par la suite voler un peu trop près du soleil. Raison de plus pour profiter des irrésistibles morceaux de Lodger. Comme Grisé n'a certainement pas manqué de le faire...
Pour assister à la première partie de la tournée, c'est par là:
LES 14 PREMIERES DATES DE LA TOURNEE

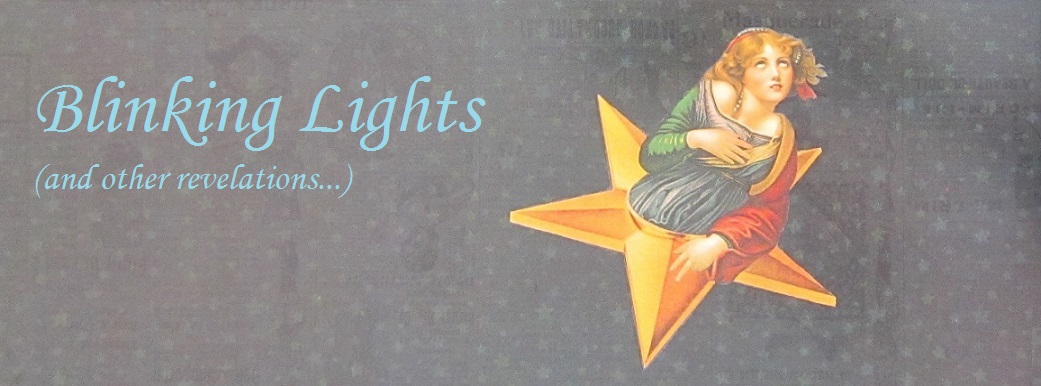
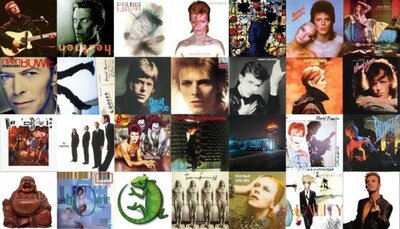


/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F09%2F01%2F1353178%2F109874607_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F36%2F76%2F1353178%2F112440408_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F48%2F05%2F1353178%2F103573225_o.jpg)